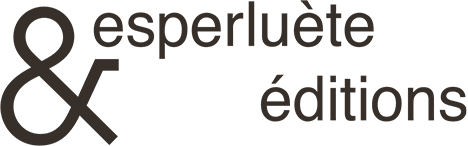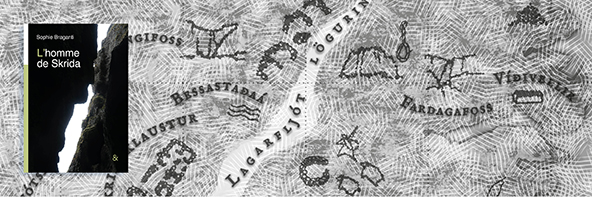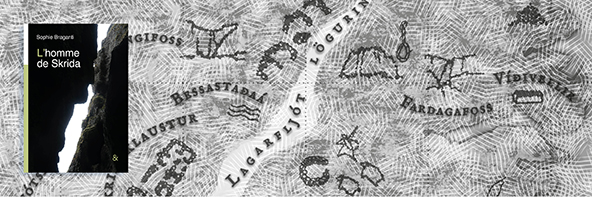
« La magie a opéré : le livre fermé, cet ami reste avec moi. À son tour il me suit dans les ombres de mes imaginaires »
Coup de coeur de Patrick Joquel, revue Traversées, avril 2025
C’est un récit poétique écrit en Islande, en automne. Un homme, une vie. Entre XVe et XVIe siècle. Quelques ossements. Quelques mots sur un cartel. C’est tout. Une époque. Une île.
Sophie Braganti y séjourne quelques semaines. Remplit ses cahiers d’impressions, d’images, d’informations. Son appareil photo aussi. Elle marche dans les landes, sous les brumes et brouillards, sous le ciel bleu aussi, dans les vents d’automne, avec le silence à la main. Elle marche, elle roule en vélo. Elle emmagasine de la solitude. Et puis elle écrit. Elle imagine la vie d’un homme.
Sous la forme d’un long poème épique en plusieurs chants, elle m’a entraîné dans l’ombre de cet homme d’une vingtaine d’années, 1,63 mètres dont les ossements ont été exhumés tombe 130. J’ai donc marché dans les traces de ce jeune homme, de sa famille ; puis de son départ vers le Monastère où un frère le prendra en charge. Une vie simple. Ou plutôt simplement une vie. La magie a opéré : le livre fermé, cet ami reste avec moi. À son tour il me suit dans les ombres de mes imaginaires.
Une belle réussite que cet homme de Skrida.
À offrir aux amoureux de l’Islande et de ses grands espaces bien sûr, mais aussi aux grands adolescents qui cherchent leur chemin. À toutes celles et à tous ceux qui donneraient quelques heures de leur vie (ou davantage) pour se laisser détourner des urgences quotidiennes pour explorer un moment du passé, un moment d’imaginaire.
La mémoire palimpseste : Sophie Braganti et L'homme de Skrida
Valérie Lounas, Mare Nostrum, mai 2025
Imaginez des os, reposant « Dans un cube de verre de cinquante centimètres cubes, éclairé par une rampe de lampes LED », qui se mettent soudain à conter leur histoire. Tel est le pacte spectral que Sophie Braganti noue avec son lecteur dans L’homme de Skrida. Du cœur d’une Islande du XVe siècle, âpre et mystique, émerge la voix ténue de Thor, tiré de l’oubli par une « elle » contemporaine, figure de l’archéologue-écrivain qui ausculte les strates du temps. Avec une singularité formelle saisissante, Sophie Braganti exhume un destin et orchestre une polyphonie intime où le souffle spectral réinvestit les silences de l’histoire. Il ne s’agit point ici d’une restitution servile, mais d’une véritable archéologie sensible, où le verbe, précis comme une sonde et vibrant comme une corde, explore les béances de la mémoire pour redonner une présence vibrante aux échos des disparus.
Dialogue spectral : le "Je" réincarné
La fiction s’amorce sur une confession posthume, celle de Thor, l’homme de Skrida, dont la voix émane d’un présent muséal avec ce cube de verre. Il est le témoin fragmentaire, l’un des “295 corps. Sans nom.”, dont la présence matérielle – les ossements – sert de portail vers une Islande révolue. Sa parole, cependant, ne surgit pas ex nihilo. Elle est convoquée, recueillie par une “elle“, figure composite de l’archéologue et de l’écrivaine – double transparent de l’auteure elle-même. Cette dernière n’est pas une réceptrice passive : elle incarne la tension créatrice entre la rigueur scientifique de la fouille et l’intuition poétique de l’écriture, catalysant le récit spectral, le “palimpseste mémoriel”. La voix de Thor, reconstituée, réinventée, devient un vecteur pour explorer les profondeurs d’une existence engloutie, une incarnation sensible des strates du passé.
« Le calme et l’isolement se fondent dans la nature sauvage pour conter une vie simple protégée de la froideur des lieux par un petit bout d’humanité bâti avec abnégation »
Florent Toniello, Accrocstiches, 13 juin 2025
Le style évoque plutôt la prose coupée que la poésie proprement dite, mais le rythme que les retours à la ligne installent et les images convoquées donnent un indéniable cachet poétique à l’ensemble : « Mes pieds semblent me supplier loin des chutes des falaises dans la mer. Ils ont des sortes de pierres-hérissons installées entre les orteils, sorties des champs de lave. Les ongles comme ahuris, effrités sur les pierres ponces se dédoublent. » Sur cette « Terre insulaire dénuée d’arbres. Démunie de ses arbres au cours des siècles », ce récit d’apprentissage tout en rudesse des éléments et en douceur des sentiments à venir rappelle aussi la trilogie de romans de Jón Kalman Stefánsson.
[...]